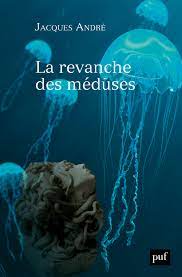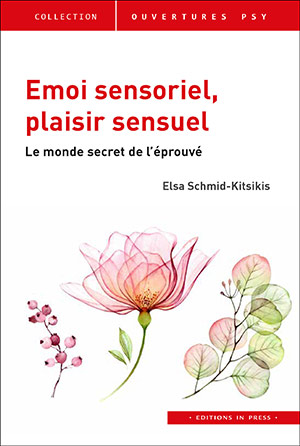CDL_Auteur Article : Dominique Baudesson
La Revanche des méduses
A l’heure de la pandémie, désastre sanitaire, qui s’est produite alors que le monde était déjà confronté à des catastrophes écologiques, liées au réchauffement climatique planétaire et à l’accroissement exponentiel de la population mondiale, Jacques André propose une réflexion psychanalytique sur les effets nocifs de l’homme sur son environnement. Les méduses, ces êtres multicellulaires … Lire la suite
Emoi sensoriel, plaisir sensuel – Le monde secret de l’éprouvé
E.Schmid Kitsikis propose une réflexion sur le statut psychique de la sensualité dans ses rapports à la sensorialité. Elle nous fait part d’une étude d’une rare qualité sur la complexité psychique de l’éprouvé, de l’émoi sensoriel en lien avec les traumas psychiques.
Le Narcissisme
Le concept de narcissisme constitue une des pierres de touche de la structuration de la personnalité. C’est ce que montre brillamment Paul Denis dans cet ouvrage clair et pertinent. Après en avoir explicité toute la prégnance en se référant à la vie d’Édouard Manet, l’auteur entreprend une étude exhaustive en exposant les différentes théories du … Lire la suite
La symbolisation
Freud a introduit une nouvelle dimension au concept de symbolisation en établissant un lien entre les symboles conscients et les symbolisés inconscients , ce qui a rendu « impérieuse » l’exigence de l’interprétation.Alain Gibeault montre les implications qui résultent de la définition de ce concept et de ses corollaires au niveau de la théorie et de la clinique … Lire la suite
L’amour de la différence
Dans Le Féminin mélancolique, Catherine Chabert s’est intéressée « aux excès narcissiques de la mélancolie » et à leur logique d’effacement comme tentative d’annulation de la différence moi/autre et de la différence des sexes. L’originalité des textes réunis dans L’amour de la différence est d’insister sur les « mouvements sexuels qui ordonnent ces configurations », sur les effets de … Lire la suite
Les enfants de l’indicible peur. Nouveau regard sur l’autisme
Psychanalyste d’orientation lacanienne, qui a été professeur à l’université Paul Valéry de Montpellier, Henri Rey-Flaud s’est notamment attaché à l’étude du fétichisme dans l’œuvre freudienne (Comment Freud inventa le fétichisme… et réinventa la psychanalyse, Payot, 1984) ainsi qu’au Moïse de Freud (Et Moïse créa les Juifs… Le testament de Freud, Aubier, 2006). Depuis 2008, il … Lire la suite
Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904
Voici la première publication en français de l’intégralité de la correspondance échangée entre Sigmund Freud et Wilhelm Fliess, compte non tenu des documents perdus ou détruits. L’édition précédente fut établie par Marie Bonaparte, Anna Freud et Ernst Kris dans les années 50 ; il s’agissait d’une version expurgée ; il ne fallait notamment pas « … Lire la suite
L’Intrus
À l’occasion de la transplantation cardiaque qu’il a dû subir, Jean-Luc Nancy réfléchit à l’existence d’un intrus, d’un étranger en soi-même. « L’intrus s’introduit de force, par surprise ou par ruse, en tout cas sans droit ni sans avoir été admis », « S’il reste étranger au lieu de simplement se « naturaliser », sa … Lire la suite
L’Utérus artificiel
L’ectogenèse, thème de L’Utérus artificiel d’Henri Atlan, est un terme inventé par John B.S. Haldane en 1923, pour désigner le développement des embryons humains hors du corps des femmes, depuis la fécondation jusqu’à la naissance. La gestation en dehors du corps d’une femme est actuellement possible du premier au cinquième jour grâce à la fécondation … Lire la suite